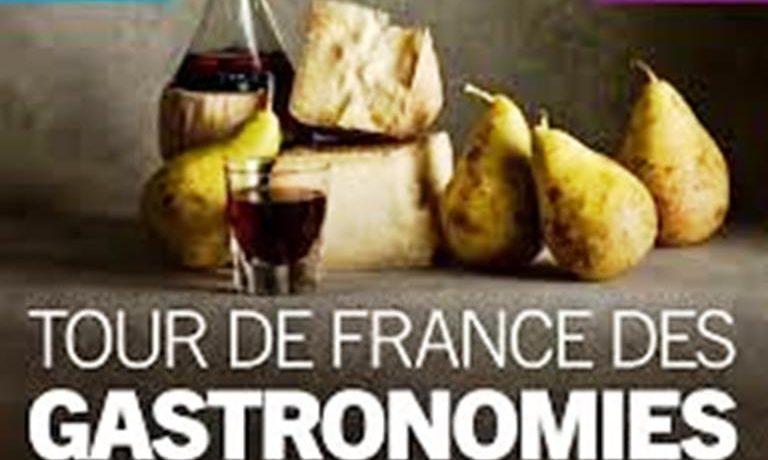Au pays de la gastronomie, des bistrots et des auberges, des petits plats et des grands crus, de la choucroute et de la bouillabaisse, chaque région conserve précieusement ses recettes et traditions culinaires.
Pour vous titiller les papilles, on vous a mitonné une sélection sucrée-salée qui devrait régaler votre curiosité.
On vous met en appétit avec quelques spécialités régionales françaises qui sortent des sentiers gourmands battus, à découvrir :
[themoneytizer id= »3420-3″]
Aligot
Si c’est d’un bon aligot dont vous avez envie, filez dans l’Aubrac ! Il se raconte qu’à l’origine, l’aligot était une soupe composée de bouillon, de pain et de tome fraîche, servie par les moines de l’Aubrac aux pèlerins en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Depuis, les pommes de terre ont remplacé les tartines mais le meilleur aligot se partage toujours selon la tradition dans les burons du plateau de l’Aubrac et de l’Aveyron. Et qu’elle est goûtue cette purée de pomme de terre bien lisse, à la crème fraîche, relevée d’une gousse d’ail et mélangée avec de fines lamelles de tome fraîche de Laguiole qui fondent dans la purée et qu’on file, file, file à s’en démettre l’épaule… mais pour la bonne cause !
Cette préparation culinaire rurale fait partie intégrante de l’histoire de l’Aveyron. Aussi, sa création fait également sujette d’une légende. Au-delà de la véritable histoire de l’Aligot, sa création est également le sujet d’une légende.
Elle raconte la rencontre de trois évêques des diocèses de Rodez, Saint-Flour et Mende, chacun avait apporté un ingrédient pour le repas :
Le Rouergat la tome,
L’évêque du Cantal le pain,
Et celui de Mende amena la crème, savoir-faire du Gévaudan.
« La croix des trois évêques », aux confins de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère rappelle cette légende.
Les moines d’Aubrac, au 12ème siècle, défrichent le plateau afin d’y développer l’élevage et la production laitière. Au monastère, parmi leurs recettes, il y avait ce mélange de mie de pain avec leur fromage « la tome » produite avec le lait de leur vache Aubrac. Ils sont alors à l’origine de l’Aligot.
Traversé par le chemin de Saint Jacques de Compostelle, l’Aubrac voyait défiler nombre de pèlerins. Ces derniers réclamaient « quelque chose » à manger (Aliquid en latin) en frappant aux portes de l’Abbaye. Au monastère, avec leur mélange de tome et de mie de pain, les moines d’Aubrac les nourrissaient de ce « Aliquid » devenu alors Aligot, qui leur redonnait force et courage.
Au 18ème siècle, à la suite d’une mauvaise récolte de blé, les buronniers remplacèrent le pain par une purée de pommes de terre dans la recette de leur Aligot. Élément clé de l’économie pastorale, l’Aligot était alors le plat de subsistance de l’Aubrac.
L’obligation de manger « maigre » le vendredi : une nouvelle chance pour l’Aligot.
Sur l’Aubrac, cette pratique religieuse conféra un intérêt particulier pour l’Aligot qui permettait de respecter ce commandement… sans trop d’effort.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : pommes de terre (de préférence des pommes de terre à purée, comme les pommes de terre Bintje), fromage frais de l’Aubrac, gousses d’ail, beurre, crème fraîche épaisse, sel, poivre…
Bettelmann
Côté sucré le « Bettelmann », aussi appelé « le mendiant » tire son histoire de l’utilisation des restes de pains rassis, de gâteaux et des fruits de saison. Ce plat du pauvre et de l’anti-gaspillage s’est enrichi de mille façons.
Le bettelmann est une pâtisserie alsacienne très ancienne. Elle est traditionnellement préparée avec des restes de pain rassis et des fruits de saison. La version la plus répandue est à base de cerises noires.
La recette nécessite des ingrédients très simples car elle est apparue après la Seconde Guerre lorsque peu de produits étaient accessibles. Le gâteau, sorte de pudding, se mangeait alors dans les campagnes après une soupe de légumes, en remplacement de la viande. Comme c’est encore le cas aujourd’hui, les fruits présents dans le bettelmann (ou mendiant) changeaient selon la saison : en début d’été on incorporait des cerises, en été des framboises ou des mûres, en automne des pommes ou des poires et en hiver des fruits secs tels que des amandes, des noix, des noisettes ou des raisins secs.
Avec le temps, la recette s’est enrichie et se sont ajoutés vanille, cannelle, gingembre, pistaches, kirsch, rhum… Le pain peut également être remplacé par de la brioche rassis. Ainsi, chacun s’approprie la recette en la faisant évoluer selon ses goûts.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : pain rassis, cannelle en poudre, lait, sachet de sucre vanillé, œufs, sucre, kirsch, cerises noires non dénoyautées, beurre…
Cacou
On espère que la moutarde ne va pas vous monter au nez ! Pour évoquer la gastronomie bourguignonne, on aurait pu vous parler des escargots (de Bourgogne), du bœuf (bourguignon) ou encore des Climats, ceux du vignoble, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. On vous le confirme : Dijon est bien une capitale gastronomique et Beaune, celle des vins de Bourgogne.
Mais sans rouler des mécaniques, on préfère vous mettre l’eau à la bouche avec le cacou, un clafoutis aux petites cerises noires locales (attention, non dénoyautées !), spécialité du sud de la Bourgogne, plus précisément du Brionnais, jardin secret de l’art roman et fief verdoyant des célèbres vaches charolaises. C’est à Paray-le-Monial que vous trouverez les meilleurs cacous. Il se dit que la recette fut inventée par un sieur Coup, au Moyen-âge, sauvant ainsi de la famine les habitants. Ce gâteau du printemps est aujourd’hui répertorié dans l’inventaire du patrimoine culinaire français et, sachez-le, une confrérie des Francs-Cacous veille au grain (et au noyau !).
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : cerises noires non dénoyautées, farine, œufs, sucre en poudre, lait entier, sel…
Cancoillotte
Cancoillotte (prononcez can-quoi-yote), quel drôle de nom ! Il faut être originaire du Jura ou de Franche-Comté pour avoir entendu parler de cette spécialité fromagère au lait de vache, à tartiner généreusement ou à faire gratiner pour napper un plat de pommes de terre. Aux côtés du comté, du mont d’Or ou du morbier, la cancoillotte, qui existait déjà au 16ème siècle, fait honneur aux fromages du Grand Est.
Une pâte blanchâtre semi-liquide obtenue à partir de lait écrémé caillé, mis à fermenter puis fondu, à feu doux, avec de l’eau salée et du beurre. On vous l’accorde, l’aspect n’est pas très engageant. Mais la cancoillotte est souvent aromatisée (ail, fines herbes, échalote, kirsch…) et surtout, réputée pour être l’un des fromages les plus diététiques qui soient (si, si !). En randonnée ou à la ferme, dans les belles montagnes du Jura, c’est toujours un mets de choix et 100% local.
La Cancoillotte est avant tout le fromage du pays comtois, en particulier du bas pays (la Haute-Saône et les vallées) où le lait est abondant. Dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura la fabrication d’autres fromages (comté, morbier, mont d’or, bleu de Gex, tome du Jura …) est privilégiée. Alors laissez-vous tenter !
Elle s’obtient à partir du Metton (lait écrémé caillé) mélangé avec de l’eau et additionné de beurre à la fin de la préparation. C’est le fromage le plus léger qui existe avec seulement 12 % de matières grasses sur le produit fini ! C’est une pâte filante, onctueuse, presque liquide.
Cannelés de Bordeaux
Craquer pour le cannelé de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine
Commençons par lever un doute. Cannelé peut s’écrire avec deux N ou un seul (selon la confrérie du canelé de Bordeaux). Il serait une variante des millassons de Bigorre, mélange de farine de millet, de sucre, d’œufs, de lait et de zeste de citron eux-mêmes largement inspirés… de la pâte à crêpe.
Le secret pour réussir ces petits gâteaux à chair tendre au délicieux goût de rhum et de vanille, c’est une cuisson lente dans des petits moules en cuivre cannelés qui leur assurent une carapace caramélisée et un cœur fondant. Après une bonne douzaine d’huîtres du bassin d’Arcachon, quelques cannelés en dessert feront toujours l’affaire. À Bordeaux, ceux de Baillardran et de la Toque Cuivrée sont les plus réputés.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : lait entier, beurre, sucre en poudre, farine type 55, œufs entiers, gousses de vanille, rhum ambré…
Pour le graissage des moules : beurre de cacao fondu…
Civet de lièvre
Originaire des campagnes françaises, le civet de lièvre est une manière traditionnelle de cuisiner cette viande giboyeuse.
Le terme « civet » est d’origine occitane. Il dérive de « cive » et « civette », qui nommaient les mets préparés avec des oignons, de l’ail ou de la ciboulette. Contrairement au lapin dont la chair est claire, celle du lièvre est dite noire, car très foncée. Son goût est plus prononcé que celle du lapin.
Le civet de lièvre est un ragoût riche et parfumé, mijoté longuement dans un vin rouge corsé. Les morceaux de lièvre, marinés au préalable, sont ensuite saisis et cuits lentement avec des oignons, de l’ail et un bouquet garni.
La particularité de ce plat est l’ajout de sang de lièvre en fin de cuisson, lui conférant une sauce épaisse et onctueuse, riche en saveurs. Un plat idéal pour les mois d’hiver, il est souvent servi avec des légumes racines ou des pommes de terre.
Traditionnellement, le civet est préparé la veille pour intensifier ses saveurs, avant d’être réchauffé et servi le lendemain.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : lièvre découpé en morceaux, vin rouge corsé, oignons, ail, bouquet garni (thym, laurier, persil), lardons ou morceaux de poitrine fumée, sang de lièvre, farine, sel, poivre…
Farci poitevin
L’origine exacte du farci poitevin demeure quelque peu mystérieuse, perdue dans les brumes du temps. Cependant, les historiens s’accordent à dire qu’il trouve ses racines dans la cuisine paysanne de la région du Poitou, une terre fertile au patrimoine agricole riche.
Le farci poitevin serait né au XIXème siècle, dans le pays Civraisien entre Poitiers et Confolens. Autrefois connu sous le nom “far”, cette recette populaire est une sorte de hachis de légumes feuilles, de mie de pain, d’oeuf et de lard, le tout enfermé et cuit dans des feuilles de choux.
Vous avez donc plusieurs possibilités pour manger la plus fameuse spécialité salée du Poitou. Elle se sert principalement froide en entrée, accompagnée d’une salade ou de crudités. En plat principal, elle est juste délicieuse tout juste sortie du bouillon, en accompagnement d’un rôti ou d’une viande grillée.
Le Farci poitevin est connu dans la région dès le début du XIXe siècle sous le nom de “fars”. Il constituait autrefois un plat de pauvre, car il servait à consommer les surplus de légumes du jardin. Devenu un met emblématique de la région, une enquête menée en 1980 auprès des écoliers a montré qu’il arrivait en tête parmi les plats considérés comme particulièrement typiques du Poitou. II existe aussi le Farci charentais qui se distingue par l’absence de chou.
Il est impossible de savoir de quand date la première recette de cette terrine. À l’origine, la recette transmise de génération en génération était préparée pour les buffets campagnards.
Pour remettre le farci au goût du jour, une petite entreprise s’était lancée dans sa fabrication semi-industrielle, au début des années 80. « Le premier objectif, expliquait le directeur adjoint des Salaisons du Poitou, à l’époque, c’est d’implanter un réseau de distribution fort dans le Poitou, et le deuxième but c’est de le faire connaître en dehors des frontières régionales, ce qui est beaucoup plus difficile. »
Effectivement, depuis, le farci a toujours du mal à sortir des frontières de la région, peut-être à cause de son aspect peu attrayant. Mais le plat reste un bonheur pour les papilles des amateurs d’oseille de la région.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : oseille, épinards, petites laitues, cœur de petit chou frisé, feuilles vertes de bettes, persil, ciboulette, branchette de thym, lard gras, farine, œufs, sel, poivre, épices…
Fiadone
En faire tout un fromage avec le fiadone en Corse
Figatellu, coppa et lonzu… le trio de choc de la charcuterie corse fait forcément frétiller les papilles encore plus lorsqu’il est servi dans une auberge du cap Corse, une bergerie de montagne dans l’Alta Rocca ou partagée dans un refuge du GR20. Sur l’île de beauté, le fromage est une bombe de saveurs, le plus connu étant bien sûr le brocciu, fromage frais préparé à partir de petit lait de chèvre ou de brebis, à la texture granuleuse et au goût très doux.
On en met dans les beignets et les cannellonis mais il est surtout l’ingrédient principal du fiadone, LE dessert corse. Œufs, sucre et zestes de citron (voire liqueur de myrte) complètent la recette de ce flan onctueux et doré. À déguster à la fin de l’automne ou en hiver lorsque le brocciu est le meilleur.
Le fiadone est un gâteau corse pouvant s’apparenter au cheese-cake, composé principalement de citron et de Brocciu, un fromage frais fabriqué traditionnellement à partir de lait entier de chèvre ou de brebis issue d’une race corse. Le Brocciu bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis 1998. Sur l’île de beauté, il est une véritable institution, tout comme le fiadone. Une citation du poète Émile Bergerat datant du XIXe siècle reprend d’ailleurs cette idée : « Qui n’en a pas goûté ne connaît pas l’île »…
Pour trouver l’origine du fiadone, il faut remonter jusqu’au XVIe siècle à l’époque où ses ancêtres les « fiadoni », sorte de flans italiens, étaient préparés. Peu à peu, le fiadone fait son apparition en Haute-Corse, dans les régions de Bastia et de Corte. En véritable tradition paysanne, il représentait le gâteau phare des familles corses, dégusté lors des moments importants : fêtes de fin d’année, Pâques, mariages, baptêmes, anniversaires… Aujourd’hui, il est toujours très consommé par les Corses qui apprécient tant son onctuosité que son petit côté acidulé…
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : Brocciu, œufs, sucre en poudre, zeste d’un citron non traité, sel, beurre, eau-de-vie corse…
Gratin dauphinois à l’ancienne
Le gratin dauphinois ou pommes de terre à la dauphinoise est un plat gratiné traditionnel de la cuisine française, d’origine dauphinoise (Sud-Est de la France), à base de pommes de terre et de lait.
Le gratin dauphinois tire son nom de l’ancienne province du Dauphiné, aujourd’hui couvrant principalement les départements de l’Isère et de la Drôme. La première mention officielle de ce plat apparaît en 1788, quand il fut servi lors d’un dîner offert par Charles-Henri, duc de Clermont-Tonnerre, alors lieutenant général du Dauphiné.
À cette époque, ce plat simple mais délicieux consistait en fines tranches de pommes de terre cuites lentement dans du lait ou de la crème liquide, sans fromage, contrairement à certaines variantes modernes que l’on pourrait trouver. Le résultat était une combinaison fondante et savoureuse qui symbolisait parfaitement l’art de vivre à la française.
Au fil des ans, le gratin dauphinois est devenu un symbole de convivialité et de partage familial. On le préparait souvent pour les grandes occasions ou les repas en famille, puisque c’est un plat facile à préparer en grande quantité et particulièrement réconfortant. Chaque famille ajoutait sa petite touche personnelle, mais respectait généralement les ingrédients de base : pommes de terre, crème liquide, ail, sel et poivre.
Ce plat simple mais délicieux est composé de fines tranches de pommes de terre, de crème et d’ail. Les ingrédients sont disposés en couches dans un plat, puis cuits au four jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés.
Bien que de nombreuses variantes existent aujourd’hui, le véritable gratin dauphinois à l’ancienne se distingue par son absence de fromage. C’est la crème et l’ail qui lui confèrent sa saveur caractéristique.
La texture crémeuse des pommes de terre fondantes combinée à la douceur de la crème et au piquant de l’ail fait du gratin dauphinois un incontournable des tables françaises.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : pommes de terre à chair ferme, crème fraîche épaisse, gousses d’ail, noix de muscade, beurre, sel, poivre…
Kig ha farz
Avec le kig ha farz, l’affaire est dans le sac en Bretagne. Le sarrasin ou blé noir apparaît au XVIe siècle et va rapidement s’imposer dans les terres pauvres de la Bretagne intérieure puis remplacer le froment pour l’alimentation. N’étant pas une céréale, de nouvelles recettes s’imposent pour pouvoir utiliser cette farine.
Si l’on vous dit spécialités bretonnes, c’est aux crêpes et aux galettes que vous pensez d’emblée. Mais la Bretagne a de quoi vous nourrir plus généreusement, surtout après une randonnée dans les monts d’Arrée ou une balade à vélo sur la côte des Légendes. Originaire du pays de Léon, dans le Finistère nord, entre Brest et Morlaix (incluant Ouessant et Molène), le kig ha farz (qui signifie “viande et far” en breton) est le pot au feu local, un plat du pauvre qui a gagné ses lettres de noblesse dans toute la Bretagne.
Des légumes, du bouillon, un assortiment de viandes de porc, voilà pour la base. Et donc il y a le farz, ce gâteau de sarrasin (et oui, on y revient toujours) que l’on fait cuire dans un sac en toile, plongé directement dans le bouillon et qui en prend tous les arômes. On le sert émietté avec viande et légumes, le tout arrosé de lipig, beurre salé fondu avec oignons ou échalotes.
Le Kig Ha Farz est une recette bretonne originaire du pays de Léon. Cette région de Basse-Bretagne se situe dans le Finistère, entre Morlaix et Brest. En breton, Kig Ha Farz signifie littéralement « viande et far ». Cette spécialité régionale est souvent appelée pot-au-feu breton, mais elle est bien plus gourmande. Kalon vat (bon appétit) !
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : lard, carottes, oignons, poireaux, chou frisé, navets, bouillon de légumes, farine de blé noir, œufs, beurre, lait, sel, sacs en tissu et de la ficelle…
Matelote d’anguille
Ce plat traditionnel met en valeur l’anguille, poisson autrefois très populaire dans les régions fluviales françaises.
Cette matelote s’est popularisée à la fin du XVIII e siècle dans les guinguettes des bords de Marne (rivière) et de la Seine, où était servi du « guinguet », petit vin blanc aigre et bon marché produit en Île-de-France.
La matelote d’anguille est un ragoût où l’anguille est coupée en tronçons et mijotée dans un bouillon à base de vin rouge ou de vin blanc, selon les régions. Les échalotes, champignons, lardons et parfois quelques morceaux de poisson complètent le mélange.
Le caractère de ce plat réside dans sa sauce dense et riche, agrémentée de beurre et relevée par le vin. Parfait pour les soirées fraîches, il rappelle les bords de la Seine ou de la Loire.
La matelote est souvent accompagnée de pommes de terre ou de pain frais pour saucer.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : anguille fraîche, nettoyée et coupée en tronçons, vin blanc ou rouge, échalotes, champignons, lardons, bouquet garni (thym, laurier, persil), beurre, farine, sel, poivre…
Navettes
Aix-en-Provence a ses célèbres calissons, mais connaissez-vous les navettes, qu’on trouve notamment à Marseille ? Certes, la bouillabaisse prend tout le soleil mais ces petits biscuits secs en forme de barque, préparés traditionnellement en Provence pour la Chandeleur et délicatement parfumés à la fleur d’oranger, font partie du patrimoine gourmand marseillais.
Chaque 2 février, on célèbre la Chandeleur à l’abbaye Saint-Victor à Marseille puis on va en procession au Four des Navettes, la plus vieille boulangerie de la ville. Pour un goûter ou une virée dans les calanques, c’est là que vous ferez vos emplettes ou aux Navettes des Accoules, dans le pittoresque quartier du Panier.
Petit biscuit en forme de barque et aux senteurs de fleur d’oranger, la navette est à elle seule une invitation au voyage.
Son histoire est étroitement liée à un quartier : celui de l’abbaye Saint-Victor et du Vieux-Port. Les premières traces historiques de sa célébration, le jour de la Chandeleur, remontent à l’an mille, sous l’influence de l’abbé bénédictin Isarn.
Selon la légende, au 1er siècle de notre ère, une barque aurait transporté les Saintes Maries jusqu’au rivage provençal. Lazare aurait été accompagné de Marthe, Marie-Madeleine et ses deux sœurs Jacobé et Salomé, Sarah leur servante, Maximin, Sidoine, Joseph d’Arimathie et d’autres disciples de Jésus, bannis de la Terre Sainte pour avoir prêché la nouvelle religion chrétienne.
La forme des navettes rappelle donc le bateau à bord duquel les Saintes et Lazare ont apporté l’Évangile en Provence. Et cette forme évoquerait également pour certains, la fécondité.
Depuis le Moyen Âge, Saint-Victor est un lieu de pèlerinage dédié au « martyr marseillais Victor », ainsi qu’à d’autres saints dont l’abbaye possédait les reliques. On peut également admirer au sein de l’abbaye, la « Vierge Noire », Notre-Dame de Confession, dont la petite statue en noyer est toujours au cœur des cérémonies du 2 février.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : farine, sucre en poudre, huile d’olive, eau de fleur d’oranger ou zeste d’orange, œufs, sel…
Pâté lorrain
Ce chausson salé est un trésor de la Lorraine, mêlant porc et veau dans une pâte feuilletée croustillante.
Originaire de la Lorraine, le pâté lorrain est considéré comme le plus ancien pâté en croûte de France. Il est composé de viandes de porc et de veau assaisonnées de vin blanc et d’épices, enveloppées dans une pâte feuilletée dorée.
Sa saveur est un mélange harmonieux entre la douceur du veau, le caractère du porc et la légèreté du vin blanc. Cuit au four jusqu’à ce que la pâte soit dorée, ce pâté est souvent dégusté lors d’occasions spéciales en Lorraine.
Traditionnellement, le pâté lorrain est servi en entrée, accompagné d’une salade verte et d’un verre de vin blanc.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : viande de porc et de veau hachées, vin blanc de lorraine, pâte feuilletée, échalotes, ail, noix de muscade, sel, poivre, jaune d’œuf (pour dorer)…
Potée Lorraine
La Lorraine, avec ses hivers rigoureux, a engendré des plats réconfortants et riches.
La potée lorraine est une spécialité rustique qui trouve ses origines dans la campagne lorraine. Composée principalement de viandes, légumes et saucisses, c’est un plat complet qui offre réconfort durant les froids hivernaux.
Ce plat se démarque par sa cuisson lente qui permet à toutes les saveurs de se mêler harmonieusement. C’est une potée qui allie simplicité et goût, une véritable signature de la cuisine française traditionnelle.
Les pots en terre cuite avec couvercle ajusté sont des récipients utilisés depuis des siècles. Ils étaient même très appréciés durant l’époque romaine.
Les soldats s’en servaient pour transporter de la nourriture et de l’eau. Ils l’utilisaient également pour cuire leurs repas lorsqu’ils installaient leur camp.
Ce mode de cuisson lente est idéal pour les personnes qui souhaitaient manger sainement. Il convenait aux personnes qui travaillaient dans les champs, car il évitait d’avoir des problèmes gastriques.
Il répond aux attentes de ceux qui veulent consommer des plats riches en micronutriments et à faible teneur en matière grasse. Il permet ainsi de réduire les calories des repas.
Grâce à la vapeur, les ingrédients ont une texture moelleuse et facile à mâcher. Ce mode de cuisson fait également ressortir les arômes des légumes, permettant ainsi de déguster un met savoureux.
Le secret de la potée lorraine réside dans sa cuisson lente et prolongée. C’est ce processus qui permet à tous les ingrédients de libérer leur saveur et d’offrir ce goût unique. Une fois la cuisson terminée, servez bien chaud.
Traditionnellement servie lors des grandes occasions ou des rassemblements familiaux, la potée lorraine est une invitation au partage et à la convivialité.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : porc (palette, travers, lard), saucisses de Montbéliard, chou, carottes, pommes de terre, navets, poireaux, gros sel, baies de genièvre…
Poule au pot
La poule au pot est un plat emblématique, souvent associé au roi Henri IV qui souhaitait que chaque Français puisse en manger le dimanche.
L’origine de ce plat traditionnel de la cuisine Française est intimement liée à celle du bon Roi Henri IV natif de Pau. Le Roi de France Henri IV établit et démocratise la poule au pot au XVIIe siècle en réponse aux famines issues des longues guerres de religions opposant protestants huguenots et catholiques.
Il s’agit d’une poule farcie, cuite lentement dans un bouillon avec des légumes. La farce est généralement composée de pain, de lard, d’œufs et de fines herbes.
La cuisson longue et douce garantit une viande tendre et savoureuse ainsi qu’un bouillon riche et parfumé. Une fois cuite, la poule est découpée et servie avec les légumes et le bouillon.
Ce plat complet et nourrissant est une célébration de la simplicité et du goût authentique.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : poule, carottes, poireaux, navets, céleri, oignon, clous de girofle, bouquet garni…
Pour la farce : pain rassis, lard, persil, œufs, sel, poivre…
Pounti
De la conviviale fondue savoyarde aux ravioles de la Drôme en passant par le poulet de Bresse, les quenelles, la brioche aux pralines, le saucisson brioché (à savourer dans un bouchon lyonnais !), sans oublier Beaujolais et grands crus des côtes du Rhône, la gastronomie en Rhône-Alpes est une fête permanente. En bonne voisine, l’Auvergne comble aussi les estomacs avec ses plateaux de fromages et sa truffade légendaires.
Mais connaissez-vous le pounti ou l’art très ancien, notamment dans le Cantal, d’accommoder les restes de viande et autre morceaux de lard et jambon avec du lait, des œufs, de la farine quelques blettes ou épinards et surtout des pruneaux pour confectionner ce gâteau-terrine sucré-salé ? On le coupe en tranches qu’on sert habituellement légèrement poêlées. De passage en Auvergne, on vous conseille d’y goûter.
Le Pounti est une spécialité cantalienne. C’est un cake sucré salé à base de farce verte dans laquelle on rajoute des pruneaux. La légende veut que les marchands de toiles qui partaient en Espagne faire le plein de marchandises, en remontant, faisaient provision de pruneaux à Agen.
Le Pounti Made in Champeyroux est le fruit d’un savoir-faire unique qui trouve son inspiration en Auvergne. De la viande de porc du Cantal, des épinards quelques pruneaux… compose cette délicieuse tartinade. Le grand classique de la gastronomie auvergnate.
Les produits qui composent le pounti sont issus de la ferme : porc, blettes, herbes, œuf, lait et farine, ce qui en fait un véritable plat paysan. À l’origine, cette spécialité locale avait été imaginée afin de cuisiner les restes de viande qui n’étaient pas utilisés pour la soupe. Comme à l’époque, on y ajoute également des pruneaux, puisqu’il était coutume de mélanger salé et sucré pour créer un plat unique et nourrissant. On partageait alors ce repas rustique et délicieux en famille ou bien dans les champs puisque sa consistance le rendait facile à transporter.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : feuilles de blettes, chair à saucisse, reste de viande : poitrine fumée, potée, rôti de porc haché…, gros oignon, gousse d’ail, botte de persil, farine, œufs, lait, pruneaux dénoyautés, sel, poivre…
Quenelles lyonnaises
La quenelle est une spécialité de la cuisine lyonnaise. La paternité de la quenelle lyonnaise est revendiquée en 1907 par Louis Légroz de la charcuterie Au Petit Vatel, à Lyon. La quenelle nature se compose obligatoirement de semoule de blé dur ou de farine, de beurre, d’œufs, de lait et/ou d’eau et d’assaisonnements.
Ces délicieuses boulettes de pâte sont le joyau de la gastronomie lyonnaise, souvent accompagnées d’une sauce riche au homard ou à l’écrevisse.
Les quenelles lyonnaises, douces et moelleuses, trouvent leurs origines dans la ville de Lyon, souvent surnommée la capitale gastronomique de la France. Elles sont généralement préparées à partir d’une pâte à base de semoule ou de farine, mélangée à des œufs et du beurre, avant d’être pochées dans du bouillon.
Une fois cuites, ces boulettes sont souvent nappées d’une sauce riche, généralement une sauce Nantua à base d’écrevisses. Leur texture légère et leur goût subtil en font un favori parmi les gourmands.
Traditionnellement servies comme plat principal, elles incarnent l’essence de la cuisine de bouchon, ces petits restaurants typiques de Lyon.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : semoule ou farine, œufs, beurre, bouillon de volaille, écrevisses (pour la sauce Nantua), tomates, oignons, cognac, crème fraîche…
Salade lyonnaise
Au XIXème siècle, les cuisinières bourgeoises s’émancipent et se mettent à leur compte. On les appelle les “Mères Lyonnaises“. Elles rendent populaire la cuisine lyonnaise : une cuisine simple et authentique, et rendent célèbres les recettes des spécialités lyonnaises, dont celle de la salade lyonnaise.
Cette salade généreuse est un symbole de la cuisine lyonnaise, mêlant saveurs rustiques et textures variées.
La salade lyonnaise combine de la salade frisée ou de la scarole, des lardons croustillants, des croûtons dorés et un œuf poché. Le tout est arrosé d’une vinaigrette à base de vinaigre de vin et de moutarde.
Ce mélange sucré-salé, doux et croustillant, est une entrée ou un plat léger idéal. L’œuf poché, avec son jaune coulant, ajoute une touche gourmande.
C’est un plat simple, mais riche en saveurs, reflétant parfaitement le caractère convivial de la cuisine lyonnaise.
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : salade frisée ou scarole, lardons, œufs frais, tranches de baguette, vinaigre de vin, moutarde, huile, sel, poivre…
Teurgoule
Se tordre la tête avec la teurgoule en Normandie
Il paraît que les initiés peuvent les déguster fumantes dès le petit déjeuner. Nous, on vous dispense volontiers de goûter aux fameuses tripes à la mode de Caen, même si cette spécialité de Normandie est réputée pour son raffinement. Pommes, pommes, pommes, pommes… c’est plutôt le cidre et la tarte normande qui font l’unanimité.
Les becs sucrés devraient aussi apprécier la teurgoule, un genre de riz au lait à la cannelle qui faisait se tordre la goule (la tête en patois normand) lorsque les gourmands la mangeaient encore chaude. La terrine ou jatte à bec en grès émaillé qui servait traditionnellement à sa cuisson est toujours fabriquée par quelques artisans potiers, notamment à Noron-la-Poterie dans le Calvados. À partager en famille ou entre amis, accompagnée de brioche dorée et d’un bon cidre normand. On valide !
C’est à la fin du 18ᵉ siècle qu’un officier de la marine française ramène en Normandie du riz de l’étranger. Personne n’avait jamais entendu parler de cette céréale et de ce fait, personne ne savait la préparer. L’une des recettes expérimentées à cette époque fût « La teurgoule ». Le nom, de cette recette sucrée provient du patois normand et signifie « la bouche tordue ».
La Teurgoule est une spécialité culinaire de Normandie qui remonte au XVIIIe siècle et qui aurait été inventée par François Orceau de Fontette, intendant de la Généralité de Caen nommé par Louis XV en 1752.
À Caen, la teurgoule est une spécialité culinaire normande depuis des décennies. Cette recette est réalisée dans un plat traditionnel en grès élaboré par la célèbre famille Turgis à Noron-la-Poterie, dans le Calvados (14). Également appelée la teurd-goule, ce nom provient de l’expression « se tordre la goule ».
Les divers ingrédients utilisés pour réussir la recette sont : lait entier, riz rond, sucre en poudre, cannelle, sel…
[themoneytizer id= »3420-3″]
Partager la publication "Tour de France des cuisines régionales en plusieurs spécialités insolites"